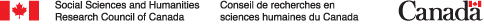Relief
Résultat d'une histoire géologique remarquable, le relief de Terre-Neuve et du Labrador a été façonné au fil de millions d'années par le choc des continents, l'orogenèse, le volcanisme, les océans, les rivières et les glaciations. Le milieu physique qui marque l'aboutissement de ces phénomènes est à lui seul un élément important du patrimoine de la région.

Le détroit de Belle Isle divise la province en deux régions géographiques, soit le Labrador et l'île de Terre-Neuve, sur le tracé approximatif d'une division d'importance géologique considérable. Le Labrador représente la partie la plus orientale du Bouclier canadien, une vaste région surtout formée de roches plutoniques et métamorphiques, dont certaines sont les plus vieilles de la planète.
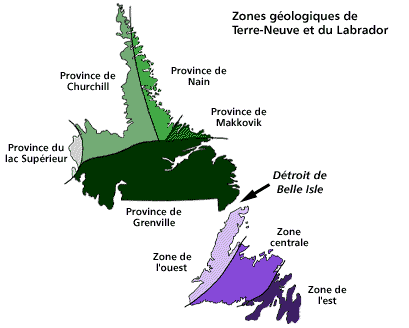
Située à la limite nord-est de la chaîne des Appalaches en Amérique du Nord, Terre-Neuve est beaucoup plus jeune que le Labrador. Elle a été constituée il y a environ 400 millions d'années lorsque trois régions de la planète ont été amenées à fusionner par la dérive des continents, ce constant déplacement des plaques lithosphériques à la surface de la Terre. Le centre de Terre-Neuve est le vestige du fond de l'océan qui séparait l'Amérique du Nord de l'Afrique il y a 500 millions d'années. La côte ouest de l'île est un fragment de l'ancienne marge continentale de l'Amérique du Nord. Quant à la côte est, elle faisait autrefois partie du sud-ouest de l'Europe ou du nord du continent africain. Lorsque les plaques continentales se sont à nouveau dissociées, donnant naissance au bassin de l'océan Atlantique, elles se sont rompues plus à l'est, laissant accrochée à l'Amérique du Nord une partie de la plaque orientale.

Depuis 200 millions d'années, l'histoire terrestre de Terre-Neuve et du Labrador est caractérisée par l'érosion. Durant l'essentiel de cette période, les rivières ont décapé les roches de la surface pour les charrier vers les océans, les déposant au large des côtes. De longs épisodes d'érosion fluviale ont favorisé la formation de vastes plaines, encore observables aujourd'hui dans les hautes terres de la Province.
Au cours des deux millions d'années qui ont précédé le peuplement, Terre-Neuve et le Labrador ont vu avancer et reculer à plusieurs reprises d'immenses nappes glaciaires. Au plus fort de la dernière glaciation, il y a 18 000 ans, l'Inlandsis laurentidien a recouvert la plus grande partie du Canada, y compris le Labrador et l'extrémité de la péninsule Northern, sur l'île de Terre-Neuve. Le reste de l'île était enseveli sous son propre champ de glace, qui avait pris naissance sur les hautes-terres de l'intérieur pour dévaler vers les régions côtières.
Les glaciers ont eu un impact considérable sur le relief, aplanissant et polissant de vastes régions, affouillant les bassins de lacs et taillant de profondes vallées entre les montagnes. Le long de la côte, ces vallées allaient ensuite être envahies par la mer et devenir des fjords profonds.

Lorsque le climat s'est réchauffé, les glaces se sont retirées vers l'intérieur, laissant un relief adouci couvert par endroits de till ou de gravier déposé par les eaux de fonte.
Le niveau de la mer autour de Terre-Neuve et du Labrador a changé considérablement à la suite de la dernière glaciation. Les nappes de glace ont fait s'enfoncer le territoire sous leur poids colossal, les écrasant vers l'extérieur au-delà de la marge des glaciers. Au gré de la fonte des glaces, les terres se sont relevées et les matériaux déplacés ont graduellement recouvré leur position originale. à peu près partout dans la Province, à des dizaines, voire à des centaines de mètres d'altitude, on peut observer des plages, des deltas et des fossiles de faune marine qui sont autant de vestiges de cette histoire.

La côte du Labrador continue de se relever, le territoire reprenant sa place. À l'opposé, la majeure partie de Terre-Neuve s'enfonce, les matériaux déplacés reprenant leur place et le terrain se stabilisant. Rivages submergés, migration des plages vers l'intérieur et forêts inondées sont tous des signes révélateurs de l'impact de l'élévation du niveau de la mer sur le littoral.